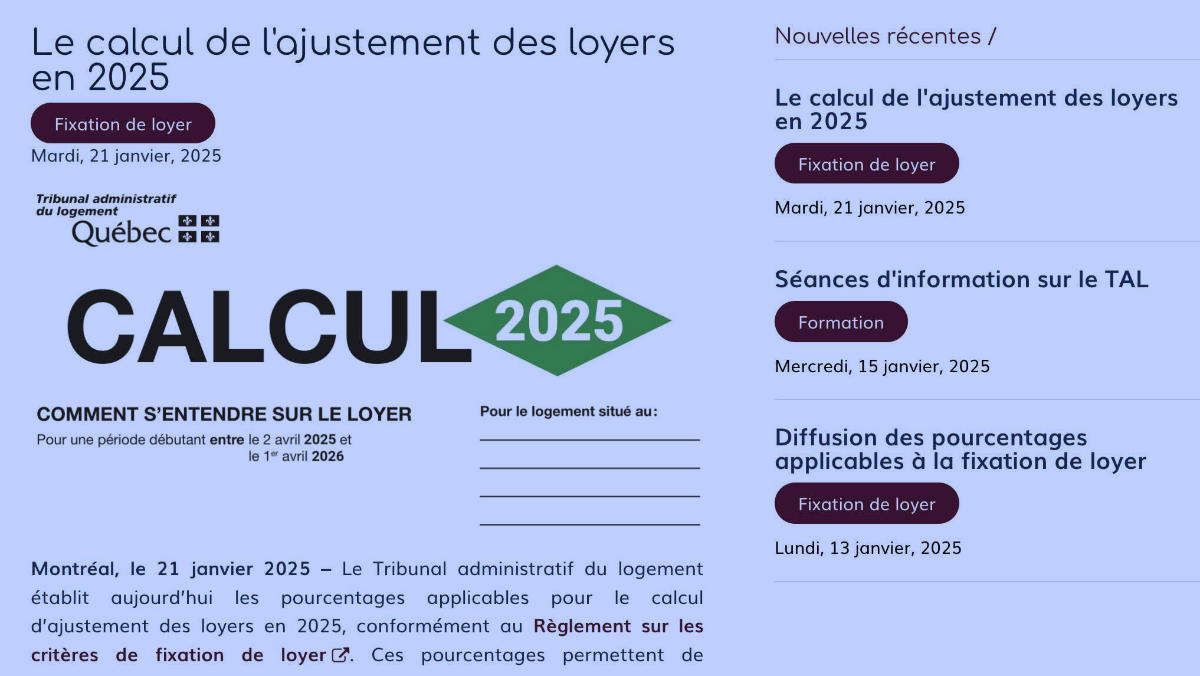Le contexte économique du Québec n’a jamais été aussi sombre.
En pleine crise du logement, exacerbée par des politiques publiques (et municipales) ouvertement hostiles aux jeunes Québécois qui rêvent d’avoir une maison, on se retrouve, individuellement et collectivement, avec des défis de société qui pourraient mener à une détérioration importante du tissu social, basé historiquement sur nos solidarités intergénérationnelles.
Nul besoin de feindre l’ignorance de ce phénomène. Il a lieu, sous nos yeux et des millions de Québécois à loyer, par obligation, sombrent inlassablement dans le désespoir et la misère financière pour enrichir des propriétaires de logements qui, trop souvent, marquent l’imaginaire (et le portefeuille) de leurs locataires par leur rare-avarice… et leur relative inhumanité.
Autrement dit, le « village », au Québec, est… brisé.
Et aucune mesurette de pacotille ne peut changer le cours de l’effondrement sociétal qui menace le Québec et surtout, ses plus jeunes qui s’épuisent à cumuler les emplois (insuffisamment payés) pour boucler leur budget, dans le contexte scandaleux des hausses de loyers à répétition et sans fin.
Plusieurs personnes plus âgées remarquent ce qui se passe.
Et certaines de ces personnes, conscientes de leur rôle en société, se demandent comment ils pourraient disposer de manière intelligente de leur maison (ou condo, ou autre) au moment de leur mort.
Dans cet article, vous comprendrez comment une succession s’avère être un véhicule de choix pour « donner » une maison, au moment de la mort du précédent propriétaire qui aurait fait inscrire cette volonté, via sa succession.
Socialement, ce geste de grande générosité intergénérationnelle pourrait avoir pour effet de sauver le Québec, tel que nous l’avions précédemment rêvé.
Une dernière chance pour les jeunes Québécois, pour ainsi dire, via une synergie engageante avec des personnes âgées qui, au moment de leur départ, auront planté un espoir inespéré dans le coeur de ceux qui leur succéderont, en tant que nouveaux propriétaires.

Au Québec, un propriétaire peut techniquement donner sa maison à une autre personne mais cela n’est pas exempt de conséquences fiscales, tant pour le donateur que pour le bénéficiaire.
Voici une explication claire et concise, voire un guide vers la réussite d’un tel projet:
Pour le propriétaire (donateur):
Pour le bénéficiaire:
Autres considérations:
En résumé, donner une maison sans conséquences fiscales est rare et dépend de la situation (résidence principale, lien familial, valeur du bien). Pour éviter des surprises, il est fortement conseillé de consulter un notaire ou un fiscaliste spécialisé au Québec.

Au Québec, posséder une maison est devenu un rêve hors de portée pour une grande partie des jeunes adultes et de la classe moyenne. Les prix de l’immobilier ont explosé, les salaires stagnent, et l’accès au marché semble réservé à une élite financièrement favorisée.
Dans ce contexte, les successions pourraient représenter une des rares avenues réalistes pour des millions de Québécois qui souhaitent un jour devenir propriétaires.
Mais quels sont les avantages concrets pour le propriétaire qui choisit de transmettre sa maison par succession, et pour celui ou celle qui la reçoit ? Examinons cela de plus près.

Pour un propriétaire de maison, planifier la transmission de son bien via une succession offre plusieurs bénéfices, tant sur le plan fiscal que personnel, soit:

Pour le bénéficiaire nommé dans la succession, recevoir une maison peut changer la donne dans un marché immobilier quasi inaccessible :

Alors que les prix des maisons au Québec continuent de grimper – dépassant souvent le million de dollars dans les grands centres comme Montréal – les successions pourraient devenir une bouée de sauvetage pour des millions de Québécois.
Pour les propriétaires, c’est une manière de transmettre un patrimoine sans les tracas fiscaux immédiats d’un don de leur vivant.
Pour les bénéficiaires, c’est une chance unique d’accéder à la propriété dans un système où épargner pour une mise de fonds relève de l’exploit.
Cependant, cette avenue n’est pas sans défis.
Les propriétaires doivent planifier leur succession avec soin, idéalement avec l’aide d’un notaire, pour éviter des complications légales ou fiscales pour leurs héritiers.
De plus, tous les Québécois n’ont pas un parent ou un proche en mesure de leur léguer une maison. Malgré ces limites, dans un paysage immobilier aussi déséquilibré, la succession demeure une des rares lueurs d’espoir pour rééquilibrer les chances et redonner vie au rêve de la propriété.

La structure sociale actuelle divise.
Les enfants en service de garde (incluant des bébés), les enfants en milieu scolaire, les jeunes adultes dans des emplois sans issue, les adultes qui hésitent à lancer leur propre famille ou encore, ceux qui ont déjà un ou plusieurs enfants et qui en arrachent, les séniors qui ont un petit coussin et de l’expérience professionnelle mais qui savent que là, c’est la santé qui peut jouer des tours et les personnes du 3e âge qui se retrouvent en RPA ou en CHSLD.
Donc: de la division, partout.
Les synergies historiques entre les générations doivent être rebâties parce qu’elles ont bel et bien été détruites, avec tout le monde dans sa petite « cage à poule » et peu de réelles interactions riches, entre les plus jeunes et les plus vieux.
À mon sens, ça prend un effort collectif.
Et le fait d’avoir une maison est encore fondamental pour espérer pouvoir fonder un foyer aussi stable et efficace que possible. Même si le rêve n’est plus qu’un rêve, il faut se donner les moyens de passer outre les limitations du modèle social individualiste actuel.
D’où l’idée, pour une personne plus âgée qui se sait en fin de vie, de donner sa maison à un propriétaire plus jeune qui pourrait la reprendre (via une succession, en bonne et due forme) mais pas l’acheter.
La logique veut qu’une fois de l’autre côté du voile de la passation vers l’outre-monde, les possessions matérielles n’ont plus d’importance. Cette idée n’est pas applicable pour ceux qui ont déjà une descendance nommée par voie de testament, bien évidemment mais comme il y aurait des centaines de milliers de personne âgées sans descendance ou famille (identifiée ou connue), l’approche du don via la succession, pour une maison, pourrait ouvrir une toute nouvelle avenue de solidarité intergénérationnelle.
Socialement, c’est à chacun de nous d’user de créativité parce qu’on l’a vu, fois après fois, ce ne sont pas les politiques publiques qui vont aider à l’accession à la propriété. Les gouvernements taxent et favorisent les lobbys-du-gros-cash alors c’est entre nous qu’il faut trouver des solutions.
Par exemple, si une personne âgée donne sa maison, en succession, à un jeune couple de Québécois, ceux-ci seraient peut-être ravis d’intégrer cette personne à leur réalité et du coup, ça pourrait contribuer à resserrer des liens qui, autrement, n’auraient pas pu advenir.
Et hypothétiquement, si ce jeune couple pouvait emménager avec la mort de l’actuel propriétaire, ceux-ci pourraient compenser avec un loyer et des soins courants pour la personne âgée qui en a besoin. Du moment que tout est officialisé devant un notaire (ou autrement, advenant), ce serait-là une approche gagnante pour tous.
Plus il y aura de tels arrangements et plus nos solidarités sociales seront fortes… et fonctionnelles.
Les villes et villages revivront, les personnes âgées ne seront plus seules, la pression sur la demande pour des logements baissera, graduellement (avec les baisses de prix qu’il serait alors nécessaire d’appliquer, pour demeurer cohérents avec la demande en baisse) et ça faciliterait une détente sur l’économie et le terrible phénomène de l’inflation (le vol invisible de vos fonds, en devises fiat).

Comme je l’ai spécifié, ce n’est pas pour tout le monde.
Mais…
Si de plus en plus de ces arrangements successoraux adviennent, les maisons demeureront des lieux de potentiels infinis pour les occupants du Québec qui s’en serviront pour bâtir un monde de nouvelles solidarités… et d’humanités.
Parce qu’on va se le dire, le « système » actuel est largement inhumain.
Alors si on veut cultiver l’humanité, c’est à nous de semer en conséquence et en conscience de ces facteurs.