

Le don d’organe se veut être un acte généreux destiné à sauver des vies. Un tel don repose sur des décisions personnelles et des protocoles médicaux stricts.
Au Québec, la loi encadre cette pratique, en respectant les volontés individuelles.
Cependant, des controverses persistent autour du diagnostic de mort cérébrale qui est une condition préalable au prélèvement d’organes chez les donneurs décédés.
Dans cet article, nous allons voir comment refuser explicitement le don d’organe (au Québec), en s’appuyant sur des sources officielles et en prenant le temps, aussi, d’expliciter les risques associés à des diagnostics erronés.
Il s’agit de vous informer afin d’aider votre prise de décision éclairée.
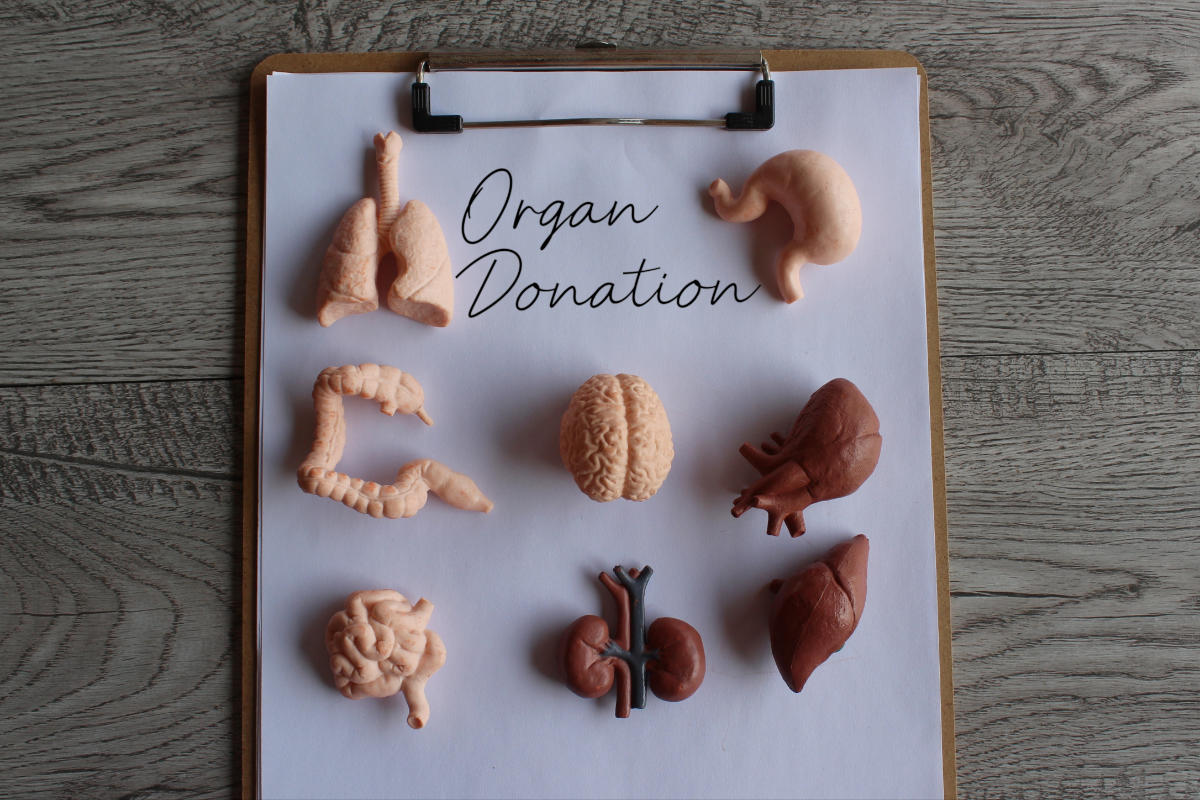
Au Québec, le don d’organe est régi par le Code civil du Québec (articles 43 à 45), qui stipule que les volontés du défunt doivent être respectées en priorité.
Si aucune volonté n’est exprimée, la décision revient à la famille proche. Transplant Québec, l’organisme provincial responsable, coordonne les prélèvements uniquement après confirmation de la mort, qui peut être neurologique (mort cérébrale) ou cardiocirculatoire.
La mort cérébrale est définie comme la perte irréversible de toutes les fonctions du cerveau, incluant le tronc cérébral, confirmée par des examens cliniques stricts : absence de conscience, de réflexes pupillaires, de mouvements spontanés, et un test d’apnée positif.
Deux médecins indépendants doivent valider ce diagnostic et la température corporelle doit être d’au moins 36°C pour éviter des faux positifs dus à l’hypothermie.
Ces critères, alignés sur les lignes directrices canadiennes de 2023, visent à uniformiser les pratiques et minimiser les erreurs.
Malgré ces protocoles, le consentement reste volontaire. Le Québec fonctionne sur un système d’adhésion explicite: personne n’est présumé donneur sans inscription.
Il existe plusieurs registres pour exprimer son choix et il est recommandé d’en informer sa famille pour éviter des conflits.

Refuser le don d’organe est un droit fondamental et plusieurs méthodes officielles permettent de le formaliser.
Voici les étapes principales, basées sur les directives gouvernementales:
Ces méthodes assurent que votre refus est respecté, mais il est conseillé d’en combiner plusieurs pour plus de sécurité. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment.

Bien que les protocoles québécois soient rigoureux, des cas internationaux et canadiens soulignent les dangers potentiels d’un diagnostic erroné de mort cérébrale. Ce diagnostic repose sur des examens cliniques et paracliniques mais des facteurs comme l’hypothermie, des intoxications ou des blessures graves peuvent mimiquer une mort cérébrale réversible.
Dans de rares instances, des patients déclarés en mort cérébrale ont montré des signes de récupération, menant à des débats éthiques sur le prélèvement d’organes.
Cela pose un risque : un patient pourrait être visé pour un don alors qu’il a encore besoin de ses organes pour survivre et se rétablir.Un exemple réel illustre ce danger : le cas de Thomas « TJ » Hoover, un Américain de 36 ans au Kentucky, en octobre 2021. Après une overdose, Hoover a été déclaré en mort cérébrale et préparé pour un prélèvement d’organes. Sur la table d’opération, il s’est réveillé, montrant des signes de vie comme des mouvements et des larmes, forçant l’arrêt de la procédure.
Sa famille a rapporté que les médecins l’avaient initialement jugé irrécupérable, mais il a survécu et vit aujourd’hui avec des séquelles.
Ce cas a provoqué une enquête et des réformes potentielles aux États-Unis, et a même impacté les taux de dons en France, où des rumeurs ont augmenté les refus.
Bien que les protocoles québécois soient plus stricts (exigeant deux médecins indépendants et des tests confirmatoires), des cas similaires au Canada, comme celui de Taquisha McKitty en Ontario en 2017-2018, montrent que des familles ont contesté des diagnostics, prolongeant la ventilation artificielle malgré une mort cérébrale confirmée.
Ces incidents rappellent que, même avec des safeguards, des erreurs humaines ou des variations dans l’interprétation peuvent survenir, potentiellement privant un patient d’une chance de récupération.
Refuser le don d’organe au Québec est simple et accessible via les registres officiels mais il est crucial d’informer sa famille pour éviter des malentendus.
Les dangers liés à des diagnostics erronés de mort cérébrale, bien que rares, soulignent l’importance d’une vigilance accrue et de protocoles infaillibles.
Des cas comme celui de TJ Hoover nous rappellent que la frontière entre vie et mort peut être floue et que le consentement doit être pleinement informé.
Si vous envisagez de refuser, agissez dès aujourd’hui via la RAMQ ou un notaire, et discutez-en ouvertement.
Pour plus d’informations, consultez les sites officiels du gouvernement du Québec ou de Transplant Québec.

Qui plus est, aux États-Unis, il y a de nombreux drapeaux rouges à propos des dons d’organes.
Dans une vidéo de « The Jimmy Dore Show » avec Kim Bright, les dangers du don d’organe aux États-Unis sont exposés via une enquête fédérale de 2021 sur 351 cas avortés de dons.
Près de 30% (103 cas) présentent des anomalies: au moins 28 patients n’étaient peut-être pas morts lors de l’opération et 73 montraient des signes neurologiques incompatibles avec le don.
Un exemple clé est celui de TJ Hoover, 36 ans, déclaré en mort cérébrale après une overdose au Kentucky, en octobre 2021. Préparé pour un prélèvement à l’hôpital de Baptist Health à Richmond, il s’est réveillé pendant la « marche d’honneur » (« honor walk »), affichant aussi bien des mouvements que des larmes, forçant l’annulation.
Kim Bright dénonce certains récolteurs d’organes qui deviennent graduellement désensibilisés et qui apparaissent être motivés par le profit, au point d’être comparés à des vautours, avec leurs pressions visant à procéder avec un don d’organe, malgré des signes de vie.
RFK Jr. qualifie cela d’horrifiant et appelle à une réforme.
À noter que la vidéo ne mentionne pas explicitement le Québec.
Bien que la vidéo se concentre sur les États-Unis, des situations semblables pourraient survenir au Québec en raison de protocoles similaires pour le diagnostic de mort cérébrale où des erreurs humaines (comme l’hypothermie ou des intoxications mimant la mort) restent possibles malgré des précautions plus strictes (comme les 2 médecins indépendants requis).
Aucune affaire identique à celle de TJ Hoover n’est rapportée au Québec mais des risques éthiques existent, notamment dans le don après aide médicale à mourir (AMM): pressions externes, perception publique de coercion et des défis pour distinguer adéquatement les décisions liées à l’AMM, d’une part et de don d’organe, de l’autre ce qui pourrait potentiellement mener à des dons prématurés, surtout dans les cas où le consentement n’est pas libre.
Une étude comparative identifie des faiblesses dans le processus de don d’organe, au Québec comme les registres complexes (la RAMQ et les notaires n’étant pas interconnectés), l’absence de formation obligatoire pour les professionnels et les refus familiaux élevés (à hauteur de 14,5% par ignorance des volontés du patient) ce qui augmente les risques d’erreurs procédurales similaires aux cas américains.
Des améliorations en matière de don d’organe s’imposent, au Québec incluant une loi spécifique, des audits en temps réel et une sensibilisation accrue pour minimiser les dangers courants.







